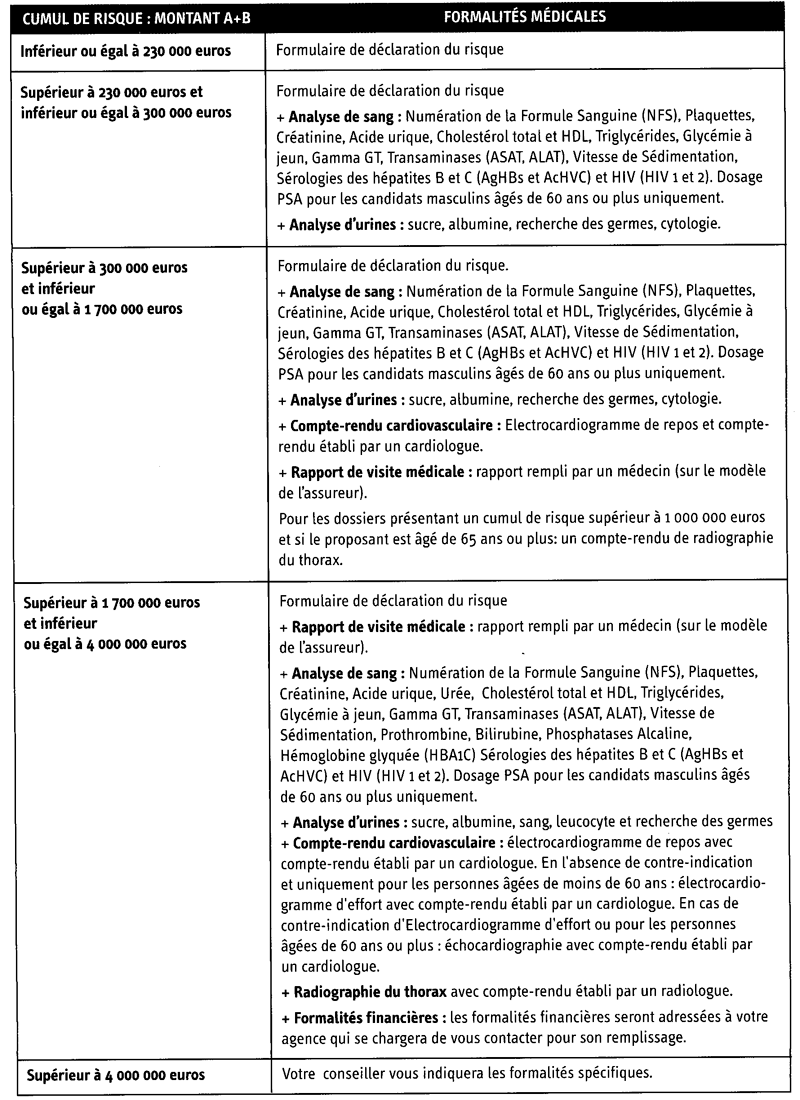Rapport adopté lors de la session du Conseil national
de l’Ordre des médecins d’avril 2000
Dr Robert SAURY
SECRET MEDICAL ET COMPAGNIE D’ASSURANCES
PREAMBULE
a) Les données du problème
L’information médicale est nécessaire à l’assureur que ce soit pour l’évaluation des
risques avant l’établissement d’un contrat ou dans l’application de celui-ci pour
l’estimation d’un dommage survenu à l’assuré.
Le problème du secret médical confronte alors le médecin traitant et le médecin de
sociétés d’assurances.
La notion fondamentale veut que seul le patient a le droit de disposer de son secret.
Le secret médical ne doit jamais être dévoilé à un tiers, même avec le consentement du
malade - et celui-ci ne peut pas déléguer à son médecin traitant le droit de disposer du
secret le concernant.
Quant à la notion jurisprudentielle du secret médical partagé, elle ne s’applique qu’aux
médecins qui concourent au diagnostic et au traitement. Or, tel n’est pas le cas du
médecin de sociétés d’assurances qui est ici un tiers.
* Toute information médicale doit donc transiter obligatoirement par l’intermédiaire du
patient.
b) La conduite à tenir pour le médecin traitant
Il doit remettre à son patient (et seulement à celui -ci ou, en cas d’incapacité, à son
représentant légal) tout document médical justificatif le concernant. (article 76 du code
de déontologie médicale)
Il doit se garder de délivrer un faux certificat ou même un certificat tendancieux ou de
complaisance (articles 24 et 28 du code de déontologie médicale).
Le médecin traitant n’a pas à répondre à une demande de renseignements médicaux qui
lui est adressée par un tiers quel qu’il soit.
c) Quant au médecin conseil de compagnies d’assurances
Il ne peut faire état dans son rapport que des informations médicales fournies
directement par la personne examinée et des documents médicaux transmis par celle-ci.
Toute information recueillie en dehors de cette personne constitue une violation du
secret médical.
Le médecin de compagnies d’assurances n’a à transmettre son rapport médical qu’au
médecin conseil du service médical de la compagnie d’assurances qui l’a mandaté (et
pas directement à l’assureur malgré l’ambiguïté des termes de la loi Badinter).
C’est à ce médecin qu’il appartiendra de communiquer à l’organisme assureur les
conséquences administratives des constatations médicales (au sens de l’article 104 du
code de déontologie médicale).
1. LE SECRET MEDICAL ET L’ASSURANCE CHEZ LE SUJET VIVANT
a) Le “ questionnaire de santé ” que l’organisme assureur demande au patient de remplir
ne peut être rédigé que par celui-ci ; qu’il s’agisse d’un questionnaire préalable à
l’établissement d’un contrat ou d’une fourniture de renseignements pour l’évaluation d’un
dommage indemnisable.
Le médecin traitant, même avec l’assentiment de son patient, n’a pas à remplir un tel
questionnaire, même en le remettant ensuite à son patient pour en disposer.
Il n’a pas non plus à valider ce questionnaire en le contresignant.
Il existe à cela une raison majeure constituée par l’existence d’une maladie grave ou
même d’un pronostic fatal qui n’a pas été porté à la connaissance du patient (article 35,
alinéas 2 et 3 du code de déontologie médicale).
En ce cas, le médecin ou bien cautionnerait un mensonge par omission et il se rendrait
alors complice d’une escroquerie à l’assurance ou bien il violerait le secret médical.
b) Le certificat médical (article 76 du code de déontologie médicale) ne peut être remis
qu’au patient lui-même par le médecin traitant. Celui-ci n’a jamais le droit de l’adresser à
la société d’assurances ni au médecin conseil de celle-ci. Seul le patient peut décider de
la communication du certificat médical qui lui a été remis notamment afin de faire valoir
ses droits. Il lui appartient alors d’adresser le document au médecin d’assurances sous
pli cacheté.
2. LE PROBLEME DU SECRET MEDICAL EN MATIERE D’ASSURANCES EN CAS DU DECES DE
L’INTERESSE
Il s’agit du certificat médical établi post mortem.
Seul le patient peut de son vivant disposer de son secret. Le médecin reste toutefois le
défenseur naturel de son malade, même après le décès de celui-ci.
Or, ce médecin traitant est tenu par le secret médical de son patient défunt et il lui est
interdit de le divulguer à l’égard d’un tiers quel qu’il soit (et notamment à un organisme
d’assurances ou à son médecin conseil ).
Cependant, tout citoyen a le droit de prendre de son vivant des dispositions en cas de
décès telles que rédiger un testament ou contracter une assurance vie.
Lorsque le médecin se trouve sollicité pour délivrer un certificat médical post mortem, il
reste seul juge de son comportement dont il doit décider en conscience. Il doit veiller
cependant à ne pas faire obstacle par son refus à des dispositions légales et priver de ce fait
les ayants droit de son patient défunt d’un avantage légitime juridiquement protégé prévu
par le contrat, tel que le versement du capital d’une assurance-vie.
Certes, le médecin traitant n’est pas l’exécuteur testamentaire de son patient. Il ne saurait
toutefois refuser d’établir un certificat médical post mortem faisant valoir les droits de celuici.
Il ne peut cependant le délivrer qu’aux ayants droit légitimes du défunt. Le médecin n’a pas
à dévoiler la cause médicale du décès, mais il a le droit d’attester que la cause de ce décès
ne figure pas parmi les clauses d’exclusion des garanties.
En matière de suicide notamment (lequel est généralement exclu des garanties
contractuelles et en tous cas dans le délai de deux ans qui suit la souscription du contrat),
le médecin ne peut ni rédiger un faux certificat (article 28 du code de déontologie médicale
et article 441-8 du code pénal) qui ferait état d’une mort de cause naturelle ni porter tort à la
mémoire de son patient en signalant le suicide.
C’est seulement lorsque la cause du décès correspond aux garanties contractuelles que le
médecin traitant peut délivrer un certificat, c'est-à-dire attestant l’existence soit d’une mort
de cause naturelle en raison d’une maladie soit du fait d’un accident (les garanties se
trouvant en ce cas souvent majorées).
Il ne peut le faire toutefois que sous la double réserve que le patient ne lui ait pas interdit de
son vivant ou que le médecin n’ait pas connaissance d’un litige existant entre les ayants
droit notamment en cas de dissentiment notoire ou de conflit successoral. C’est en effet
alors à la justice d’en décider.
3. LE PROBLEME DE L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL EN CAS D’EXPERTISE PRIVEE (qui concerne
aussi bien l’individu vivant qu’un sujet décédé)
a) Les textes actuels prévoient que le patient ne dispose pas d’un droit d’accès direct à son
dossier médical hospitalier. Il ne peut en avoir communication “ que par l’intermédiaire
d’un médecin désigné à cet effet”.
Il en est de même pour ses ayants droit (loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et
libertés, loi hospitalière du 30 juillet 1991, article L. 710-2-2 du code de la santé
publique).
b) Les documents qui composent un dossier médical ne sont définis qu’en ce qui
concerne ce dossier hospitalier (article R. 710-2-1 du code de la santé publique).
Il s’agit de l’énumération limitative des documents du dossier dit communicables en tous
cas en matière civile.
Ce n’est en effet qu’en matière pénale que la totalité du dossier peut faire l’objet d’une
saisie judiciaire ordonnée par un magistrat (et en présence d’un représentant du Conseil
de l’Ordre des médecins).
c) Quel médecin peut être désigné ?
En général, c’est le médecin traitant lequel disposant d’un droit d’accès direct au dossier
médical de son patient a ainsi vocation naturelle à être ce médecin intermédiaire.
Il reste toutefois juge des informations qu’il estime devoir communiquer.
Il n’est pas indispensable cependant que le médecin intermédiaire ait la qualité de
médecin traitant. Tout médecin peut être désigné à cet effet (arrêt du Conseil d'Etat du
22 janvier 1982).
En ce qui concerne le médecin des compagnies d’assurances, bien que la C.A.D.A.
(Commission d'accès aux documents administratifs) n’y soit pas défavorable (sous
réserve de l’article 104 du code de déontologie médicale) ; la C.N.I.L. (Commission
nationale de l'informatique et des libertés) et le C.N.O.M. (Conseil national de l’Ordre des
médecins) y sont opposés.
En effet, les dispositions des articles R. 710-2 et R.710-2-2 du code de la santé publique
(qui subordonnent à l’intermédiaire obligatoire d’un médecin désigné à cet effet l’accès au
dossier médical du patient) ont pour but essentiellement de répondre au droit
d’information du patient. Elles ne constituent pas pour autant une dérogation légale au
secret professionnel, lequel exclut les tiers.
La désignation en qualité de médecin intermédiaire d’un médecin de sociétés
d’assurances constituerait un détournement de l’esprit des lois d’accès au dossier
médical.
En effet, même par l’intermédiaire d’un médecin, l’assureur qui est toujours un tiers, ne
saurait avoir accès au dossier.
*
EN DEFINITIVE, le législateur a voulu que le patient ou ses ayants droit légitimes aient accès
au dossier médical. S’il a tenu à ce que ce soit par l’intermédiaire d’un médecin, c’est en
raison des exigences du secret médical et de la déontologie médicale. Il appartiendra en
effet à ce médecin de décider ce qui peut être considéré comme communicable dans
l’intérêt du patient et ce qui n’a pas à être divulgué pour les raisons qu’il aura à estimer en
conscience. Ce sera alors au patient lui-même ou à ses ayants droit de décider de
l’utilisation des informations qui leur seront ainsi transmises et le cas échéant, de les
adresser à la société d’assurances en cause. C’est à eux et à eux seuls qu’il appartiendra
de les communiquer éventuellement au médecin de cette société d’assurances. Il est en
effet interdit au médecin qui a accès au dossier de transmettre la moindre information à un
tiers quel qu’il soit, non seulement un assureur ou un médecin, mais également un
avocat, un notaire, un parent ou un allié. Ce faisant, il violerait en effet de manière
répressible le secret médical.
En résumé, qu’il s’agisse de l’utilisation des données du dossier médical ou de la
délivrance de tout certificat, le médecin traitant est le défenseur naturel de son patient. Il
le reste après le décès de celui-ci. C’est ce principe qui doit inspirer sa conduite.
source :
http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport ... esaury.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Document très intéressant